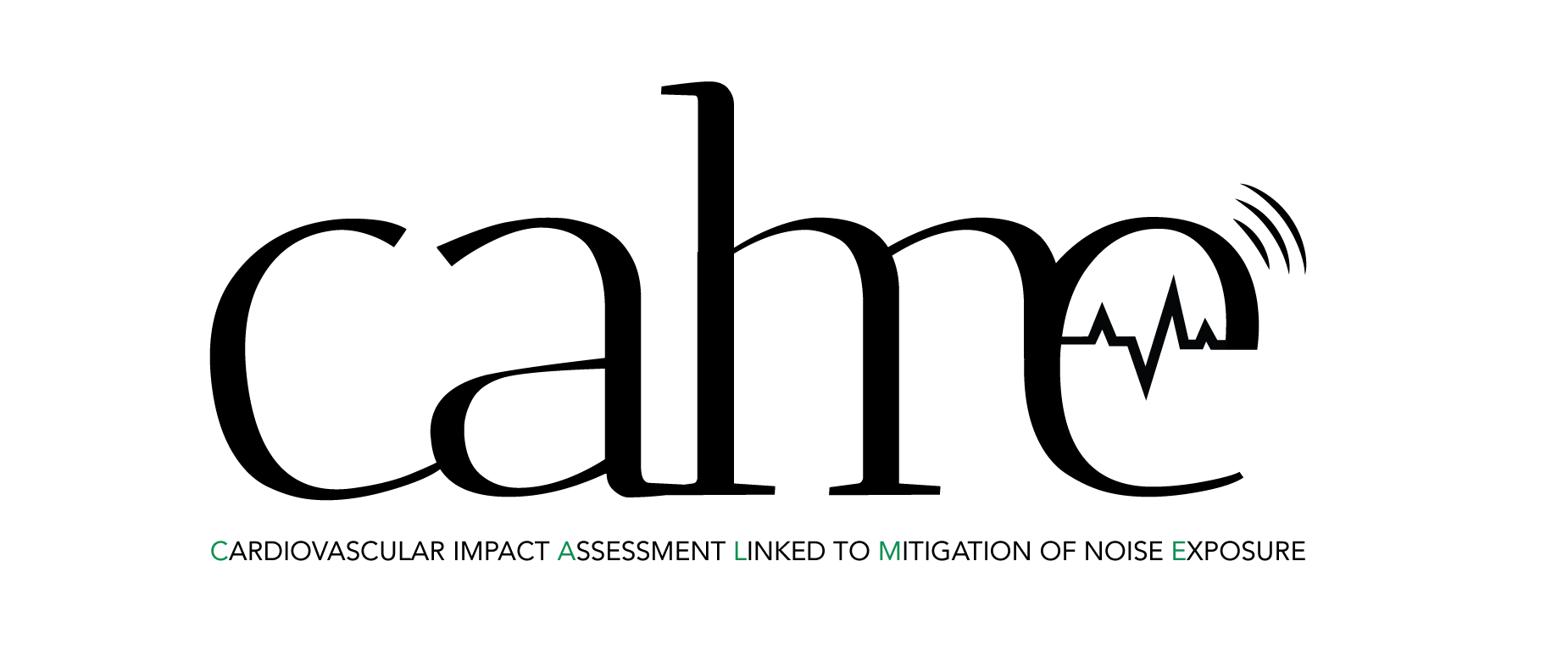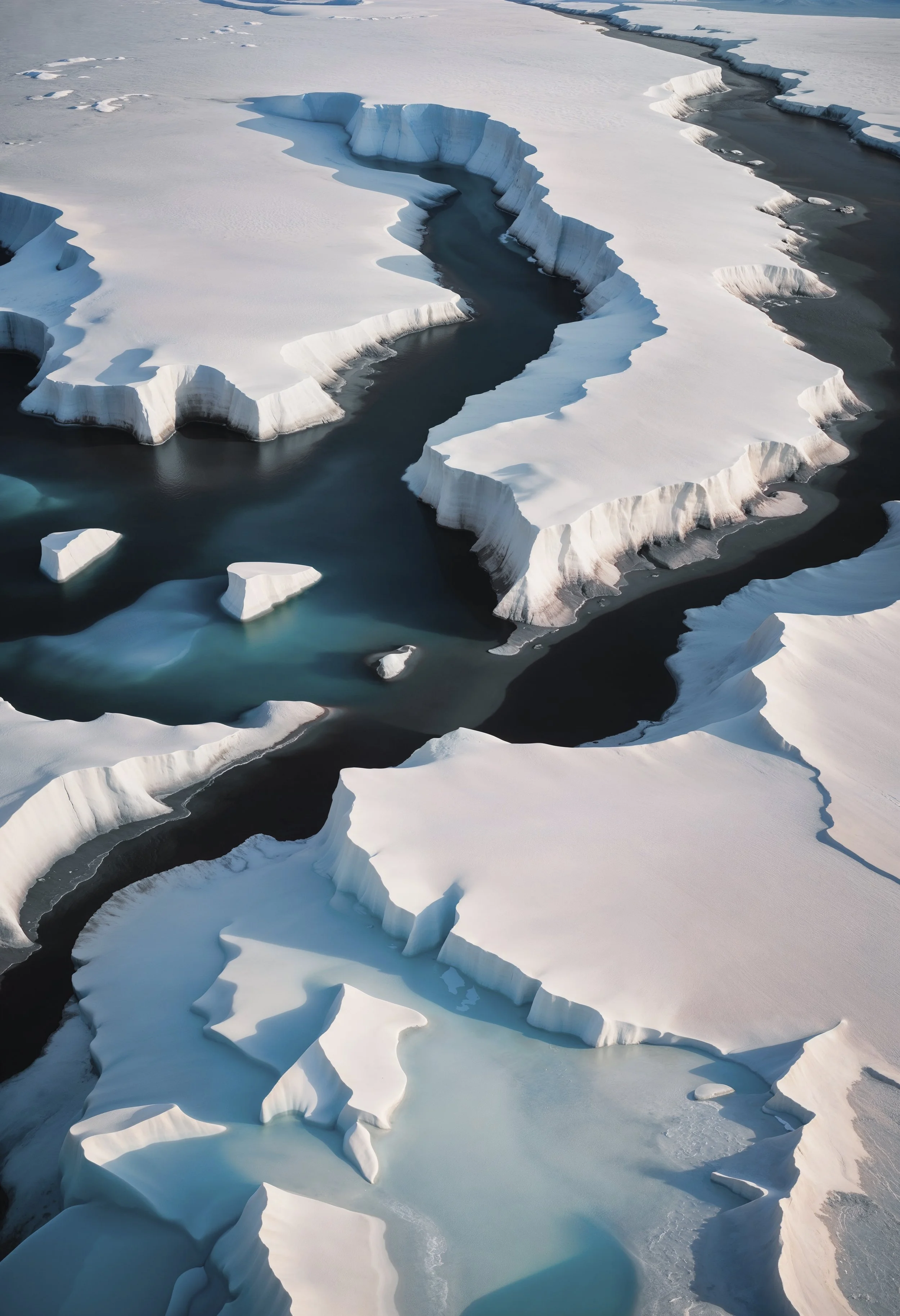inégalités sociales et environnementales de santé
calme : Cardiovascular Impact Assessment Linked to Mitigation of Noise Exposure
Objectif détaillé
Objectifs scientifiques : « Quels sont les bénéfices pour la santé cardiovasculaire associés à la réduction du bruit et comment prioriser les actions de mitigation sur les territoires les plus exposés, en particulier pour améliorer la santé des populations socioéconomiquement défavorisées ? » Objectifs techniques :
- Quantifier les bénéfices sanitaires de scénarii de réduction du bruit sur les maladies cardiovasculaires.
- Évaluer l’équité des bénéfices en examinant leur répartition parmi les populations défavorisées pour limiter les inégalités sociales de santé.
- Proposer des outils et recommandations pratiques pour aider les décideurs à identifier les scénarii les plus efficaces dans les zones prioritaires.
Argumentaire de l’originalité et/ou caractère novateur du projet
Le projet CALME se distingue par son approche novatrice en explorant les effets du bruit sur la santé cardiovasculaire, un enjeu environnemental souvent sous-estimé dans les études de santé publique, tout en intégrant les dimensions de défavorisation sociale. En prenant en compte l’interaction entre bruit et défavorisation sociale, CALME aborde un levier essentiel pour réduire les inégalités socio-territoriales de santé. Le projet identifiera ainsi les zones du territoire où les gains d’une diminution du bruit seraient les plus significatifs.
Argumentaire du choix des questions à la recherche
Le bruit est le deuxième facteur de risque environnemental en Europe, après la pollution de l'air. Des recherches récentes ont confirmé l’augmentation du risque d'hypertension, d'infarctus du myocarde, d’AVC et de cardiopathies ischémiques avec l'exposition au bruit. L'OMS estime qu'en 2011, plus d'un million d'années de vie ont été perdues à cause du bruit en Europe. En France, une étude récente menée dans trois grandes métropoles par Santé Publique France (SPF) a démontré que respecter les seuils recommandés par l'OMS pour le bruit lié aux transports pourrait améliorer la qualité du sommeil de plusieurs milliers de personnes chaque année. Toutefois, à ce jour, aucune évaluation des impacts sanitaires du bruit n’a intégré simultanément, d’une part, les effets combinés de la co-exposition au bruit et à la pollution de l’air, et d’autre part, la défavorisation sociale. Ces éléments sont pourtant essentiels pour appréhender pleinement les inégalités environnementales et de santé.
Description des méthodes mises en œuvre – éléments de calendrier
Dans le cadre de projet de recherche et de collaboration en cours, plusieurs bases de données sont déjà disponible et des indicateurs statistiques à l’échelle de l’IRIS ont déjà été calculés ou modélisés. Il s’agit :
Du bruit – des indicateurs d’exposition à l’IRIS ont été calculés avec ou sans prise en compte de la population et, avec prise en compte de la population et du type de bâtiment (habitation, école) ; il s’agit des moyennes énergétique et arithmétique. Les données ont été collectées auprès du Cerema et de l’Eurométropole de Strasbourg des indicateurs acoustiques (en dB(A)) modélisés à l’échelle de chaque bâtiment de l’Eurométropole grâce au modèle CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), pour les bruits routier, ferroviaire et celui des ICPE, conformément à la Directive Européenne 2002/49/CE.
De la pollution de l’air - Les concentrations en NO2, PM10 et PM2,5 modélisées par le modèle de qualité de l’air ADMS-Urban (développé par le Cambridge Environmental Research Consultants) à l’échelle des IRIS par ATMO Grand Est seront mobilisées. Une cartographie combinée, superposant les cartes de bruit et de pollution de l'air à l’échelle de l’IRIS permettra d’identifier les zones de co-exposition.
Défavorisation sociale - Des indicateurs de défavorisation socioéconomique existants à l’échelle de l’IRIS (Fdep, EDI) ou un indice spécifiquement construit sur l’Eurométropole de Strasbourg à partir des données du recensement de l’INSEE par Analyse en Composantes Principales permettront une compréhension précise des liens entre défavorisation et effets sanitaires.
Les évènements de santé d’intérêt – Le registre des cardiopathies ischémiques du Bas-Rhin collecte les cas de syndrome coronaire aigu (SCA) survenant chez les personnes de 35-74 ans résidant dans le Bas-Rhin. Les événements cardiovasculaires pour ce projet sont : les SCA prévalents, les SCA incidents, les accidents coronaires fatals, ainsi que les hospitalisations pour SCA. Le registre recense environ 1100 cas incidents et 500 décès par an. La période couverte par ce projet s’étendra entre 2017 à 2024. Les taux d’événements standardisés sur l’âge seront estimés. Les ratios standardisés de mortalité ou morbidité seront cartographiés à l’échelle de l’IRIS pour visualiser les variations géographiques. Ces variations seront analysées à l’aide des indices de Moran global et local, et, si nécessaire, une modélisation bayésienne sera utilisée pour affiner les estimations des risques relatifs. Le registre autorisé par la CNIL en 1997, a déposé une déclaration le 25/10/2024 pour modifier le traitement des données et intégrer systématiquement la collecte des adresses des participants dans sa base de données.
Caractérisation de la fonction dose-réponse – Les bénéfices sanitaires liés à une diminution du bruit seront estimés à l’aide d’une évaluation quantitative des impacts sanitaires (EQIS), nécessitant la connaissance de la fonction dose-réponse. Pour estimer cette fonction, une revue de la littérature (méthode PRISMA), suivie d’une méta analyse, synthétiseront les études sur le lien entre bruit et maladies cardiovasculaires. Une attention particulière portera sur les études qui auront pris en compte la défavorisation sociale en tant que modificateur d’effet.
Scénarisation – Une analyse des interventions existantes dans la littérature accompagnée d’un travail de réflexion collégial avec des spécialistes du bruit nationaux et internationaux et l’Eurométropole de Strasbourg, permettra d’estimer les mesures de réduction de bruit réalisables (changement de revêtements routiers, réduction de la vitesse etc) et d’élaborer des scénarii contrefactuels d’une EQIS.
Quantification des gains sanitaires et de l’équité – Suivant le guide méthodologique publié par Santé Publique France, des EQIS seront réalisées à l’IRIS pour les différents scénarii de réduction du bruit identifiés à l’étape précédente et les quatre indicateurs de santé cardiovasculaire. Les bénéfices sanitaires seront cartographiés et analysés à l'aide de la méthode d’identification de clusters développée par Kulldorff.
Detailed objective
Environmental pollution, particularly air pollution and noise exposure, is a major public health concern, especially in urban areas. While the adverse health effects of air pollution are well-documented, noise pollution remains underestimated. Yet, noise is the second largest environmental risk factor in Europe, significantly contributing to cardiovascular diseases through stress-related physiological and hormonal mechanisms. Chronic exposure to noise triggers an activation of the sympathetic nervous system and endocrine response, leading to hypertension, vascular constriction, and increased stress hormones, which are linked to a higher incidence of myocardial infarction, stroke, and other cardiovascular pathologies.
In France, local authorities are making increasing efforts to reduce noise levels in urban environments. However, these interventions rarely incorporate social and territorial inequalities, despite growing evidence that vulnerable populations may be disproportionately affected. Indeed, deprived populations could be more exposed to environmental risks while also being more susceptible to their adverse health effects due to pre-existing conditions, reduced access to healthcare, and lower resilience to environmental stressors. The CALME project aims to bridge this gap by integrating an equity-based approach in assessing noise-related health risks and designing more inclusive public health policies.
In this context, the main objective of CALME is to quantify the cardiovascular health benefits associated with noise reduction measures, particularly in socioeconomically disadvantaged populations. In order to prioritize interventions in areas where exposure is highest and where populations are most vulnerable, the project seeks to:
- Assess the exposure to noise and air pollution at a fine spatial scale in the Eurométropole of Strasbourg,
- Analyze social inequalities in environmental exposure and their impact on cardiovascular health,
- Estimate the health impact of different noise reduction strategies based on the health impact assessment approach.
The CALME project is based on an interdisciplinary approach, combining expertise in epidemiology, environmental sciences, biostatistics, and spatial health geography.
Key methodological steps include:
- Mapping noise and air pollution exposure at the IRIS level,
- Modeling spatial health inequalities using socioeconomic and environmental indicators,
- Quantifying the cardiovascular burden associated with noise pollution,
- Simulating different noise reduction scenarios, such as lower speed limits (zones 30 km/h), traffic flow optimization, and changes in vehicle fleets,
- Evaluating the health impact of these interventions, particularly among disadvantaged populations.
To estimate the long-term health effects, the project will rely on standardized exposure-response functions and validated epidemiological models.
In conclusion, the CALME project advances research on the health effects of noise pollution while considering social factors in public policies. By highlighting the links between noise, cardiovascular diseases, and social inequalities, it aims to support fairer and more effective health policies, promoting a healthier and more inclusive urban environment.
Mobilité maternelle, pollution de l’air et issues périnatales
Activités quotidiennes, mobilité journalière pendant la grossesse et inégalités d’exposition à la pollution atmosphérique dans les issues périnatales : une étude de cohorte
L’évaluation de l’exposition à la pollution atmosphérique pendant la grossesse repose le plus souvent sur des modèles statiques fondés uniquement sur l’adresse de résidence. Ces approches peuvent sous-estimer l’exposition réelle et fausser l’évaluation des inégalités environnementales en négligeant la mobilité quotidienne. Cette étude visait à quantifier les erreurs de classification de l’exposition liées à l’absence de prise en compte de la mobilité et à analyser leurs variations selon les groupes socioéconomiques à Strasbourg, en France.
Nous avons analysé les données de 497 femmes enceintes incluses dans la cohorte MOBIFEM. L’exposition au dioxyde d’azote (NO₂), aux particules fines PM₁₀ et PM₂.₅ a été estimée selon six scénarios : un scénario statique (adresse de résidence uniquement) et cinq scénarios dynamiques intégrant les lieux fréquentés et les trajets quotidiens. Les analyses ont été stratifiées à l’aide d’un indice local de défavorisation socioéconomique. Les concentrations horaires de polluants ont été estimées à haute résolution spatiale à l’aide du modèle de dispersion ADMS-Urban.
Les modèles dynamiques intégrant la mobilité ont systématiquement produit des estimations d’exposition moyennes significativement plus élevées que le modèle statique. La sous-estimation était la plus marquée chez les femmes résidant dans les quartiers les moins défavorisés (tertile 1). Par exemple, les écarts les plus importants d’exposition au NO₂ entre les modèles statiques et dynamiques ont été observés dans ce groupe (t = −4,72 ; p < 0,001).
Le recours exclusif à l’adresse de résidence entraîne une sous-estimation substantielle de l’exposition personnelle à la pollution atmosphérique pendant la grossesse et peut altérer la caractérisation des inégalités sociales d’exposition. Dans la zone étudiée, l’absence de prise en compte de la mobilité affecte davantage les femmes les moins défavorisées, probablement en raison de distances de déplacement plus longues. Ces résultats soulignent l’importance d’intégrer la mobilité individuelle dans l’évaluation de l’exposition afin d’améliorer la précision des analyses en santé environnementale et d’éclairer les politiques de santé publique.
Allaitement et retour au travail un enjeu de santé publique
L’Europe affiche le taux le plus bas d'allaitement exclusif à 6 mois au monde. Identifier les freins à la poursuite de l’allaitement en milieu professionnel est une priorité, particulièrement pour les femmes en situation précaire, qui cumulent davantage de difficultés. Ce travail synthétise la littérature sur les caractéristiques de l’emploi maternel susceptibles de favoriser la poursuite de l’allaitement après un retour au travail.
Les principaux déterminants étudiés incluent :
Le type d’emploi (profession, statut salarié/indépendant, type de contrat, temps de travail, prestige professionnel)
Les conditions de travail (horaires, marge de décision, flexibilité dans l’organisation du temps de travail)
L’environnement professionnel (exposition professionnelle, politiques familiales, soutien social)
Les recherches, menées en Espagne (4 études), en France (4 études), au Royaume-Uni (2 études), en Irlande (2 études) et aux Pays-Bas (1 étude), révèlent l’absence de cadre conceptuel clair sur les interactions entre travail, allaitement et inégalités sociales. Cependant, plusieurs facteurs favorables ont été identifiés :
Le statut d’indépendant
La flexibilité horaire
L’existence de salles d’allaitement sur le lieu de travail
Le soutien des collègues
La mise en œuvre de politiques favorables à l’allaitement
Pour promouvoir l’allaitement en milieu professionnel, il est essentiel de renforcer les droits des travailleuses, notamment via des pauses allaitement rémunérées, des horaires flexibles et des espaces dédiés. Les politiques publiques devraient également cibler les femmes en situation précaire avec des dispositifs adaptés, tout en sensibilisant les employeurs et les collègues à l’importance de l’allaitement. Enfin, des campagnes de sensibilisation et un suivi rigoureux des mesures mises en place contribueraient à réduire les inégalités sociales et à maximiser leur impact.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur Pubmed.fr
Cumul des expositions environnementales et inégalités sociales de santé
En Nouvelle-Aquitaine, les zones qualifiées de points noirs environnementaux, où plusieurs sources de pollution environnementale s'accumulent (pollution de l'air, des sols, nuisances sonores...), exposent leurs habitants à des risques accrus pour la santé. Pourtant, les outils d’évaluation du cumul des expositions environnementales restent rares, alors même que ces situations complexes nécessitent une action ciblée. Comprendre les interactions entre environnement et santé, identifier les populations exposées, et localiser précisément les zones à risques sont des prérequis essentiels pour agir efficacement.
Dans cette optique, une étude menée en Nouvelle-Aquitaine a développé un score de cumul d’expositions environnementales couplé à un indice de désavantage social, calculés à une échelle fine : les IRIS (îlot regrouper pour l’information statistique , unités statistiques infra-communales). Le score environnemental s'appuie sur des données libre d’accès concernant la proximité de sources de pollution (routes, voies ferrées, industries, décharges, aéroports, carrières, sols pollués, zones à risques naturels). L’indice social, quant à lui, repose sur des données sociodémographiques de l’INSEE (âge, logement, niveau d’éducation, statut migratoire). De plus, des analyses approfondies se focalisant sur une population socialement exclue : les gens du voyage, ont été réalisées en utilisant leurs lieux de résidence.
Principaux Résultats de l’Étude :
Environ 4 % des IRIS de la région sont des points noirs environnementaux ;
Ces IRIS concentrent 7,2 % de la population régionale ;
Environ 2,4 % de la population vivent dans des zones cumulant désavantage social et expositions environnementales ;
Les gens du voyage sont particulièrement impactés, avec 13,3 % d’entre eux vivant dans ces zones à risques, soit deux fois plus que la moyenne régionale.
Ces résultats démontrent l'intérêt de ce type d’outils pour visualiser les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé à une échelle géographique fine. Leur utilisation pourrait grandement contribuer à orienter les politiques publiques de santé environnementale et à prioriser les interventions dans les territoires les plus vulnérables. En savoir plus sur Cairn.info
Cliquez-ici pour consulter le rapport.
Registres épidémiologiques en France : un outil de surveillance sanitaire équitable ?
En mars 2020, face à la propagation rapide du virus SARS-CoV-2, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la COVID-19 comme une pandémie mondiale. Pour limiter la transmission du virus et préserver les systèmes de santé, de nombreux pays ont imposé des mesures de confinement strictes, incluant la fermeture des écoles. Cette décision, bien que justifiée sur le plan sanitaire, a soulevé de nombreuses inquiétudes quant à ses conséquences sur le développement, la santé mentale, l’apprentissage et le bien-être des enfants. Quels ont été les véritables impacts de la fermeture des écoles pendant la pandémie de COVID-19 sur les plus jeunes ? En savoir plus sur Soepidemio.com
-
L’école est reconnue comme étant plus qu’un lieu d’apprentissage. Les quatre piliers de l’éducation proposés par l’UNESCO sont, apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être, montrent que l’école est bien plus qu’un lieu pour recevoir des apprentissages. Lorsque les écoles sont fermées, même si l’enseignement peut être assurés par voie numérique, c’est ainsi tout un ensemble d’autres connaissances qui sont totalement ou partiellement perdues.
Fermeture des écoles pendant la COVID-19 : quel impacts sur les enfants ?
Les registres de pathologies sont des outils clés de la surveillance épidémiologique en France, définis par l’arrêté du 6 novembre 1995 comme un “recueil continu et exhaustif de données nominatives concernant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie”. Utilisés à des fins de recherche, d’évaluation et de santé publique, ces registres permettent de suivre les maladies chroniques, les cancers, ou encore les pathologies rares dans une logique de veille sanitaire territoriale. En savoir plus sur Soepidemio.com
-
La répartition inégale des registres épidémiologiques en France révèle plusieurs formes d’inégalités en santé publique.
D’abord, les inégalités territoriales : certains territoires disposent de registres actifs tandis que d’autres en sont dépourvus, limitant la surveillance sanitaire locale.
Ensuite, les inégalités de surveillance : toutes les maladies ne sont pas suivies avec la même intensité, créant un déséquilibre dans les données de santé disponibles.
Enfin, les inégalités sociales : certains registres ciblent des groupes spécifiques, ce qui peut exclure des populations vulnérables du suivi épidémiologique.
Ces disparités d’accès aux données épidémiologiques peuvent freiner la mise en œuvre de politiques de santé équitables et nuisent à la réduction des inégalités sociales de santé.
Changement climatique & politiques de santé Séminaire régional
Le 27 juin, la plateforme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes, pilotée par la DREETS, a organisé son 6e séminaire régional autour de la thématique du changement climatique et de son intégration dans les politiques publiques sanitaires et sociales.
Face aux effets croissants du dérèglement climatique sur la santé des populations, ce séminaire visait à mettre en lumière les leviers d’adaptation pour les acteurs du social et de la santé. Il a permis de croiser expertises, retours d’expérience et outils pour anticiper les risques sanitaires, réduire les vulnérabilités territoriales et repenser les politiques sociales dans un contexte de transition écologique. En savoir plus sur Pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
Les inégalités socio-environnementales de santé : du constat scientifique à l'action sur les territoires
L’existence d’inégalités socio-environnementales de santé est bien documentée. Deux mécanismes permettent d’expliquer ces inégalités : le différentiel d’exposition, qui analyse comment les populations sont inégalement exposées aux nuisances environnementales selon leur profil socioéconomique ou leur lieu de résidence ; et le différentiel de vulnérabilité, qui étudie comment les effets de ces expositions varient selon les groupes sociaux, accentuant les écarts en matière de santé.
Construire un environnement sain et favorable à une santé équitable pour tous est un enjeu central en santé publique. Cela implique de mener des actions territoriales ciblées, comme l’amélioration de la qualité de l’air, dans une logique d’universalisme proportionné, tenant compte des désavantages sociaux préexistants.
Cependant, les décideurs publics rencontrent des difficultés à intégrer les inégalités environnementales dans la priorisation et la conception des interventions, notamment en raison du manque d’indicateurs sociaux et environnementaux disponibles en routine. De nouvelles recherches s’attachent à relier les résultats scientifiques aux besoins des territoires pour une santé publique plus équitable et efficace. En savoir plus sur Canal U TV.
-
Chercheuse à l’université de Bordeaux et à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), elle travaille depuis le 1er avril 2022 sur les inégalités sociales et environnementales de santé. Auparavant, elle a exercé pendant 20 ans à l’École des hautes études en santé publique (EHESP) en tant qu’enseignante-chercheuse spécialisée en biostatistiques et en épidémiologie environnementale. Ses travaux actuels portent sur l’intégration des inégalités sociales dans les méthodes d’évaluation quantitative d’impact sur la santé (EQIS), en lien avec les politiques publiques et les actions de santé environnementale mises en œuvre dans plusieurs territoires en France. Elle développe également des indicateurs géographiques de multiexposition environnementale pour évaluer les nuisances issues de diverses sources (pollution de l’air, bruit, risques industriels, etc.) dans une logique de repérage des zones cumulant vulnérabilités sociales, environnementales et sanitaires. Ces recherches visent à mieux cibler et prioriser les interventions en santé publique et à promouvoir une meilleure équité territoriale.
Pollution de l’air : les enfants issus de milieux défavorisés sont les plus exposés
À l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air, un rapport publié le 14 octobre 2021 par l’UNICEF France et le Réseau Action Climat alerte sur les inégalités sociales face à la pollution de l’air. Ce document, fondé sur des études scientifiques, révèle que les enfants vivant dans des quartiers défavorisés sont plus exposés à la pollution atmosphérique que ceux issus de milieux plus aisés. Cette situation soulève des enjeux en matière de santé environnementale, de justice sociale et de politiques publiques ciblées sur l’amélioration de la qualité de l’air dans les territoires vulnérables. En savoir plus sur Sciences-Avenir.fr
Pollution de l’air : les enfants les plus PAUVRES sont les plus vulnérables
Plus de trois enfants français sur quatre respirent un air pollué, selon un rapport du Réseau action climat et de l’Unicef publié ce jeudi 14 octobre. Les deux organismes appellent à faire de la lutte contre ces pollutions un levier d’équité sociale.
Plus de trois enfants français sur quatre respirent un air pollué. C’est l’une des alertes lancées par le Réseau action climat et l’Unicef France. Le rapport publié ce jeudi 14 octobre par les deux associations pointe le lien « entre les inégalités sociales et l’exposition des enfants à la pollution de l’air à laquelle ils sont particulièrement vulnérables », résume Valentin Desfontaines, responsable des mobilités durables à Réseau action climat. En savoir plus sur Ouest-France.fr
Inégalités sociétales et exposome urbain : Des origines sociales pour des expositions différentes
De nombreuses études épidémiologiques montrent aujourd’hui l’association entre certaines expositions environnementales et des problèmes de santé, qu’ils soient aigus ou chroniques, à différents moments de la vie. Par exemple, la pollution de l’air est liée à une augmentation des infections respiratoires, des maladies cardiovasculaires ou encore à des complications pendant la grossesse. Les nuisances sonores peuvent également perturber le sommeil et accroître le risque de pathologies cardiovasculaires.
À l’inverse, un meilleur accès à des ressources environnementales comme les parcs, les aires de jeux ou les espaces verts favorise une bonne santé physique et mentale, ainsi que des comportements bénéfiques à long terme. Cette synthèse se concentre sur l’exposome urbain, défini comme l’ensemble des facteurs environnementaux présents dans les villes, positifs ou négatifs, influençant la santé dès la période prénatale. Comprendre l’impact différencié de ces expositions selon les contextes sociaux permet de mieux cerner les inégalités environnementales de santé en milieu urbain. En savoir plus sur Ipubli.inserm.fr
Changement climatique, inégalités et Covid-19 : un triptyque indissociable
Construire un environnement sain, favorable à la santé de tous et plus précisément envers les plus vulnérables, est un enjeu majeur si l’on veut agir pour une relance plus écologique et équitable.
Tribune.
Le changement climatique entraîne de nombreux et profonds bouleversements partout dans le monde. Ces bouleversements peuvent conduire à des catastrophes sanitaires directement liées aux conditions météorologiques extrêmes, comme l'augmentation de la fréquence des sécheresses entraînant la raréfaction des ressources en eau dans certaines parties du monde et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules. La canicule de 2003 a ainsi provoqué plus de 70 000 décès en Europe dont 19 000 en France, avec une prépondérance de personnes âgées, notamment des femmes et les études menées à la suite de cet épisode ont montré que cette mortalité était fortement influencée par des facteurs sociaux, comme les conditions de logement et l'isolement (1). Le changement climatique peut également affecter notre santé de façon plus indirecte, avec l'émergence attendue de nouvelles épidémies dont la pandémie au Covid-19 qui sévit depuis plusieurs mois et qui nous interroge sur les menaces sanitaires qui pèsent sur nos sociétés.
En quoi le changement climatique favorise l’émergence des épidémies ?
L’émergence de maladies infectieuses est favorisée par le changement climatique et la destruction de la biodiversité mais également par les transformations de nos modes de vie, comme l’augmentation de la circulation des personnes et des biens et la croissance urbaine. De nombreux virus sont sensibles aux conditions d’humidité, de luminosité et température et ont ainsi souvent un caractère saisonnier ; comme la rhinopharyngite, la bronchite ou la bronchiolite, la gastroentérite ou encore la grippe. Or les climatologues observent des bouleversements dans l’organisation et la durée des saisons ; cela pourrait avoir un impact sur les périodes de survenue des épidémies ainsi que sur leur durée. En savoir plus sur Liberation.fr
-
Ainsi, en se combinant aux processus de diminution – du nombre d’espèces sauvages – de la diversité génétique (nécessaire pour limiter les propagations des pathogènes) et de la diversité biologique qui intervient dans la régulation de la transmission des pathogènes, la mutation de certaines souches de virus serait favorisée. Les transformations de nos modes de vie, comme l’urbanisation rapide et l’existence de zones urbaines à très haute densité, la mondialisation du voyage et du commerce, quant à elles favorisent la transmission entre les individus (2). Le changement climatique est, rappelons-le, une question cruciale de santé publique : en 2016, l’OMS estimait qu’à l’horizon de 2050, environ 250 000 décès annuels supplémentaires seraient causés par le changement climatique que ce soit par stress thermique, malnutrition ou maladies infectieuses.
Comment les inégalités d’expositions environnementales participent-elles aux inégalités sociales ? La pollution de l’air contribue au réchauffement climatique ; parmi les polluants les plus connus, citons ceux émis par les moteurs de voitures, principale source d’émission dans les grandes métropoles : dioxyde de carbone, plomb, particules et oxydes d’azote ou encore l’ozone. Suivant des mécanismes documentés, certains de ces polluants de l’air sont reconnus pour contribuer à l’effet de serre. Inversement, le réchauffement climatique, par un phénomène d’augmentation des températures par exemple, va avoir un effet sur les concentrations atmosphériques.
Les effets du changement climatique n’ont pas les mêmes conséquences selon les conditions de vie des individus (lieu de résidence, ressources financières et sociales). Si on prend l’exemple de la pollution atmosphérique, elle n’affecte pas tous les territoires de la même façon. Il existe une hétérogénéité géographique qui peut être visible même à une fine échelle spatiale. Ces variations géographiques vont engendrer des disparités d’exposition à la pollution atmosphérique des populations résidents dans certaines zones.
-
Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un nombre de cas de Covid-19 et une mortalité liée au Covid-19 plus élevés sur les territoires soumis à une pression environnementale plus forte. L'hypothèse d'un lien entre exposition à la pollution atmosphérique et risque Covid-19 a été analysée à partir des données européennes (3) de mortalité associée au Covid-19 – il a été montré combien l'exposition aux NO2 (dioxyde d'azote, polluant principalement lié au trafic routier) pourrait contribuer à expliquer la distribution géographique des décès. Cette étude a notamment révélé que plus de 90% des décès pour Covid survenaient dans des régions où les concentrations maximums en NO2 dépassaient les 50mmol/m2. Or ces territoires soumis à une pression environnementale forte peuvent également être ceux où se concentrent les populations ayant un état de santé plus moins bon que les territoires où la pression environnementale est moins importante.
En France, si l’on analyse de plus près la répartition des décès liés au Covid-19, la piste d’une fragilisation des individus exposés à la pollution atmosphérique semble tout à fait plausible. Le pouvoir irritant de la pollution atmosphérique sur les voies respiratoires rendrait vulnérables certains groupes de population, augmentant ainsi le risque de contracter des formes plus graves de la maladie liée au Covid-19. Ces inégalités d’exposition à la pollution atmosphérique vont, de plus, interagir avec les inégalités sociales préexistantes. Les facteurs environnementaux sont en effet considérés comme un déterminant à part entière de la santé ; la dimension environnementale est maintenant de plus en plus intégrée à l’étude des inégalités de santé qui induisent notamment des comorbidités.
Les chiffres de mortalité liée au Covid-19 publiés par l’Insee révèlent un nombre de décès plus élevé dans le département de Seine-Saint-Denis. Ce département présente des caractéristiques socioéconomiques particulièrement défavorables avec un taux de pauvreté très élevé et le cortège de prévalences de comorbidité plus élevées que dans les départements d’Ile-de-France. Même si, à ce jour, il est très compliqué d’avancer avec certitude les raisons d’un taux plus élevé de mortalité lié au Covid-19, il est important de souligner que ce département cumule depuis plusieurs formes d’inégalités dont les inégalités sociales et environnementales (incluant l’exposition à la pollution de l’air). Les concepts d’inégalités sociales et environnementales sont donc intimement couplés.
Le changement climatique impacte plus durement les populations les plus vulnérables et est un multiplicateur des inégalités sociales et environnementales préexistantes. Lutter contre le réchauffement climatique, c’est aussi lutter contre les inégalités sociales de santé qui ne font que s’accroître ces dernières années. La crise sanitaire actuelle nous rappelle combien nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie.
(1) Vandentorren S, Bretin P, Zeghnoun A, Mandereau-Bruno L, Croisier A, Cochet C, Riberon J, Siberan I, Declercq B, Ledrans M. August 2003 heat wave in France: risk factors for death of elderly people living at home. Eur J Public Health. 2006 Dec;16(6):583-91.
(2) Bedford J, Farrar J, Ihekweazu C, Kang G, Koopmans M, Nkengasong J. A new twenty-first century science for effective epidemic response. Nature. 2019;575(7781):130–6.
(3) Ogen Y. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality. Science Total Env. 2020, 726.
Construire un environnement sain et favorable à la santé pour tous, en particulier pour les populations vulnérables, est essentiel pour promouvoir une relance économique écologique et équitable.