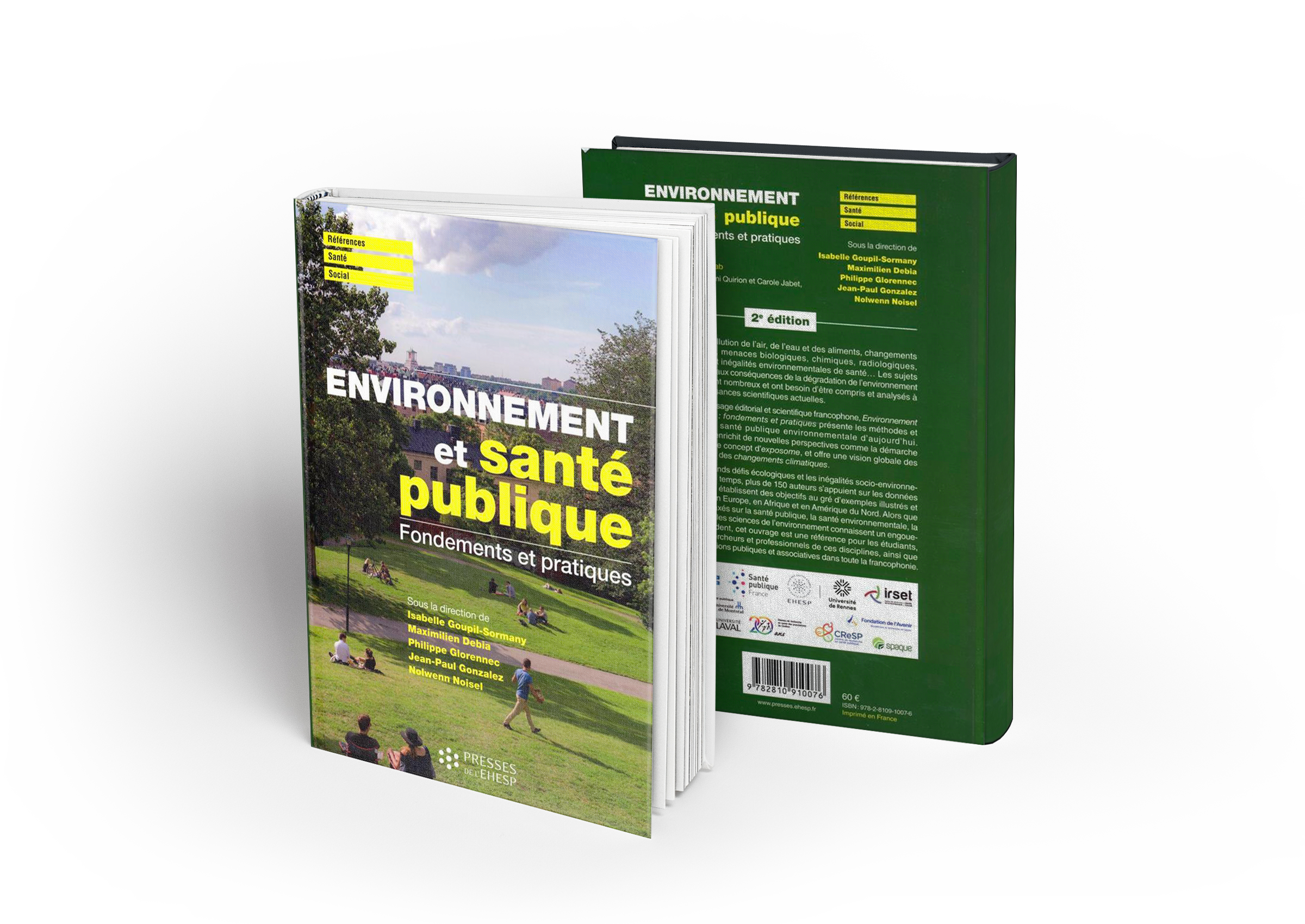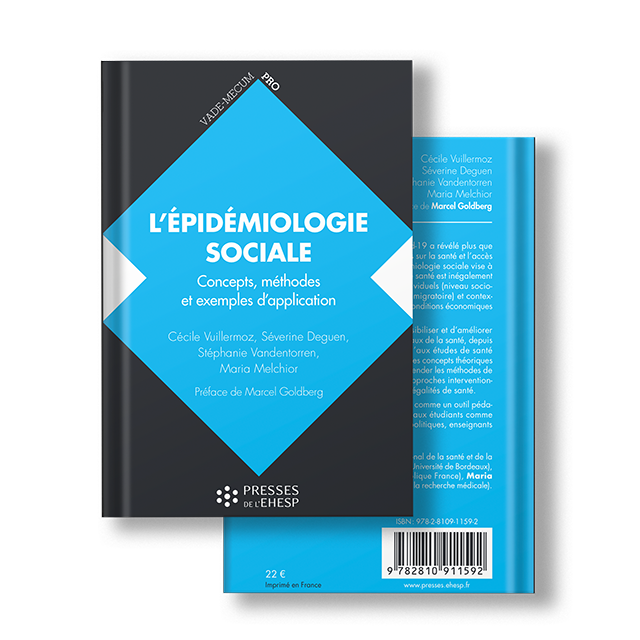Santé publique et justice sociale
la santé environnementale dans l’enfance
50ème Colloque en présentiel et distanciel - La santé environnementale, nouvelle frontière des inégalités de santé dans l’enfance ?
Cette présentation porte sur les inégalités sociales et environnementales de santé dans l’enfance, en montrant qu’elles apparaissent dès la grossesse et les premières années de vie. Elle met en évidence le rôle majeur de l’environnement, et notamment de la pollution de l’air, dans les effets sur la santé du nouveau-né et de l’enfant, avec des impacts socialement différenciés. Découvrez la brochure du Colloque ainsi que la présentation de Séverine Deguen.
LES CENTRES DE SANTÉ EN (R)ÉVOLUTION PERMANENTE
Les centres de santé publics jouent un rôle fondamental dans le système de soins français. Pourtant, ces structures font face à des défis croissants : réduction des moyens, manque de professionnels, saturation des services… Ces difficultés entraînent une détérioration de l’accès aux soins, en particulier pour les populations les plus vulnérables. On observe notamment une baisse de l’offre de soins sans reste à charge et une multiplication des dépassements d’honoraires, rendant les soins moins accessibles.
Face à cette situation, une réforme en profondeur du système de santé s’impose. Elle doit placer l’humain, la prévention, l’accessibilité et la justice sociale au cœur des politiques publiques. Les centres de santé, en tant que structures intégrées et innovantes, sont un levier essentiel pour cette transformation. Leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur ancrage territorial en font des acteurs clés pour répondre de manière durable et équitable aux besoins en santé de la population. Cliquez-ici pour voir le Programme er la Présentation.
Contribution à la Table Ronde : Prise de parole de Séverine DEGUEN sur le thème de la Santé Environnementale et des Inégalités Sociales de Santé
Pauvreté et pollution de l’air : une injustice sociale invisible
En France, plus de trois enfants sur quatre respirent un air pollué au quotidien, une réalité alarmante. Cette exposition n’est pas équitable : les populations vivant en zones urbaines denses, souvent les plus précaires, sont les plus touchées. Le trafic routier, à lui seul, est responsable de 63 % des émissions de NOx (oxydes d’azote) et de 18 % des particules fines (PM₂.₅), avec des pics bien supérieurs dans des villes comme Paris.
Les enfants, en pleine croissance, sont particulièrement vulnérables à ces polluants qui affectent les voies respiratoires, le développement neurologique et la santé globale. Ce constat met en lumière un enjeu majeur de santé publique : réduire les inégalités sociales de santé passe aussi par des politiques environnementales plus justes. En savoir plus sur Reseauactionclimat.org
la presse en parle…
Santé publique et crise sanitaire : le cas de la COVID-19
Au début de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ont adopté des mesures sanitaires drastiques, notamment la fermeture massive des écoles. Si ces décisions visaient à limiter la propagation du virus et à protéger les systèmes de santé, elles ont aussi mis en lumière des conséquences profondes sur l’éducation, la santé mentale et l’équilibre social des enfants et des adolescents.
L’école représente bien plus qu’un lieu d’apprentissage : c’est un espace de sécurité, de socialisation, d’accès à l’alimentation et, parfois, de protection contre la violence. Sa fermeture prolongée a accru les inégalités sociales entre les enfants issus de milieux favorisés et ceux vivant dans la précarité, accentuant les écarts en matière d’éducation, de bien-être psychologique et de santé.
Cette crise a souligné l’importance de penser des stratégies de santé publique équilibrées, capables de prendre en compte à la fois les impératifs sanitaires et les droits fondamentaux de l’enfant. Il est essentiel que les futures politiques de gestion de crise sanitaire intègrent pleinement les enjeux de protection de l’enfance, en particulier dans les contextes vulnérables. En savoir plus sur Asher.org
Inégalités environnementales et santé en Europe
Les conditions de vie et l’environnement dans lesquels nous évoluons ont une influence directe sur notre santé physique et mentale. Pourtant, ces conditions ne sont pas les mêmes pour tous : les populations les plus vulnérables sont souvent celles qui subissent la plus forte exposition aux polluants, à l’insécurité environnementale ou à des logements insalubres.
Le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alerte sur ces inégalités environnementales de santé, en s’appuyant sur 19 indicateurs clés : qualité de l’air, accès à l’eau potable, urbanisation, accidents domestiques ou professionnels, exposition aux risques naturels ou technologiques… Il met en évidence la nécessité de développer des politiques publiques intégrées qui agissent à la fois sur l’environnement, la santé, et les déterminants sociaux.
Ces disparités ont des répercussions sanitaires majeures, renforçant les inégalités sociales existantes. Réduire ces écarts suppose une action coordonnée et intersectorielle, impliquant les acteurs de la santé, de l’urbanisme, de l’environnement et de la justice sociale, à l’échelle locale comme internationale. En savoir plus sur Who.int
Environnement et santé publique
Une définition essentielle pour comprendre ses enjeux
La santé publique est un domaine en constante évolution, au croisement des sciences, des politiques publiques et de l'action collective. La nouvelle version du manuel franco-québécois sur l’environnement et la santé publique illustre parfaitement cette dynamique, à travers un renouvellement des auteurs et une actualisation des thématiques abordées. Elle met en lumière trois grandes évolutions : scientifique, thématique et organisationnelle.
Une notion aux multiples dimensions
le concept « santé publique » est fréquemment utilisé, mais il recouvre plusieurs définitions. Il sert à distinguer les services collectifs des services privés, mais aussi les enjeux individuels des enjeux collectifs. Pour Frenk (1993), la santé publique regroupe les actions gouvernementales, les mesures environnementales comme l’assainissement, et les services de prévention ciblant les populations vulnérables, tels que la vaccination.
Plus tôt, Winslow (1920) proposait une définition plus exhaustive toujours d’actualité :
« La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé physique et l’efficacité, par le biais d’efforts collectifs organisés, et visant la salubrité de l’environnement, le contrôle des infections communautaires, l’éducation des individus à l’hygiène personnelle, l’organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et la prévention de la maladie et le développement de l’infrastructure sociale qui assurera à chaque individu de la communauté un standard de vie adéquat pour se maintenir en santé. »
Une discipline transversale et interdisciplinaire
Les difficultés rencontrées pour définir la santé publique tiennent à plusieurs raisons : la santé est surtout vue comme un attribut individuel dont les représentations sont bien établies (maladie, souffrance, bien-être, réalisation, etc.). La « santé collective » est plus difficile à percevoir et mesurer : c’est une construction sociale et un axe autour duquel se structurent les sociétés. Du point de vue des connaissances, la santé publique n’est pas une discipline, mais un domaine d’action vers lequel convergent de nombreuses disciplines. Du point de vue des pratiques et des systèmes de santé, on observe à la fois une variété et des divergences considérables, d’où la difficulté de reconstruire empiriquement le champ d’action de la santé publique. En savoir plus sur Cairn.info
Glossaire d’épidémiologie : Comprendre les données de santé publique à l’ère de la COVID
Un ouvrage essentiel pour décrypter l’épidémiologie en période de crise sanitaire
L’année 2020 a marqué un tournant mondial avec la pandémie de COVID-19, mettant soudainement au premier plan des notions épidémiologiques autrefois réservées aux spécialistes de la santé publique. Aujourd’hui, les indicateurs épidémiologiques, les taux d’incidence, les modèles de transmission ou encore les courbes de contamination font partie du quotidien, relayés par les médias, les réseaux sociaux et les autorités sanitaires.
Dans ce contexte, il est devenu crucial pour les citoyens de comprendre les données de santé publique, afin de soutenir les politiques sanitaires, de mieux adhérer aux mesures de prévention et de développer un regard critique et éclairé sur l’information diffusée.
C’est dans cet esprit que s’inscrit ce glossaire d’épidémiologie, publié aux Presses de l’EHESP, sous la direction de Mélanie Bertin.
Un glossaire pédagogique, concret et structuré pour tous les publics
Accessible à un public non spécialiste, ce glossaire propose une approche claire et structurée des principales notions en épidémiologie. Chaque terme est défini de manière pédagogique, illustré par des exemples concrets issus de la pandémie de COVID-19, et relié à des concepts voisins pour faciliter la compréhension globale. L’ouvrage est également pratique : les notions sont classées par ordre alphabétique, avec un index thématique en fin de volume pour approfondir les domaines spécifiques (transmission, dépistage, statistiques, prévention.
Ce livre collectif a été rédigé par une équipe de 10 enseignants-chercheurs en épidémiologie et biostatistiques de l’EHESP (École des hautes études en santé publique), au sein du département Méthodes quantitatives en santé publique (Rennes).
Auteurs : Mélanie Bertin (direction), Pascal Crépey, Séverine Deguen, Olivier Grimaud, Nolwenn Le Meur, Emmanuelle Leray, Judith Muller, Cindy Padilla, Jonathan Roux, Philippe Glorennec.
Préfacé par Arnaud Fontanet, ce glossaire s’impose comme un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent maîtriser les fondamentaux de l’épidémiologie, mieux interpréter les données de santé et contribuer activement à une culture sanitaire partagée. En savoir plus sur Presses.ehesp.fr
L’Épidémiologie sociale : Comprendre l’impact des inégalités sociales sur la santé
Un ouvrage clé pour analyser les déterminants sociaux de la santé
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en lumière le rôle déterminant des inégalités sociales de santé dans l’accès aux soins et la vulnérabilité des populations. Face à ces enjeux, l’épidémiologie sociale s’impose comme un outil fondamental pour comprendre les liens entre conditions de vie, statut socio-économique et état de santé.
Cet ouvrage pratique, accessible et rigoureux, a pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé, les chercheurs, les décideurs publics et les étudiants à l’importance des déterminants sociaux de la santé dans l’analyse et la prise en charge des inégalités. En savoir plus sur Presses.ehesp.fr